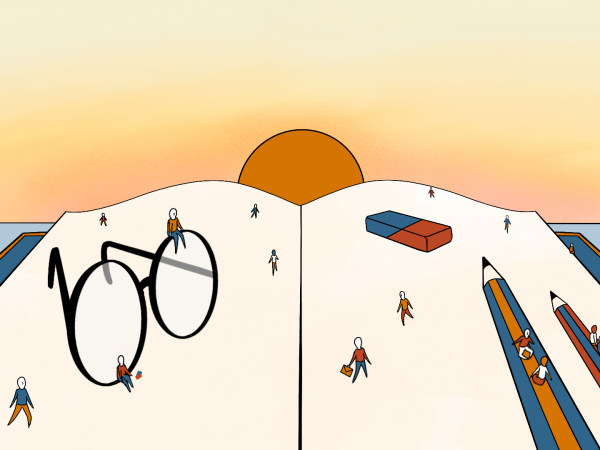« Les mots font les choses ». Cette expression, dévolue au monde social, a depuis été reprise au sujet du contexte « inclusif » des élèves à besoins éducatifs particuliers. Effectivement les mots ont un pouvoir certain sur la définition, la compréhension et l’expression dynamique des pratiques sociales et éducatives.
Leur force est de contribuer, de façon consciente ou inconsciente, au façonnage de la réalité, et un tant soit peu à la transformation des actes du quotidien. Certes « le seul changement de mot ne permettra pas de changer les pratiques, mais il permettra de penser autrement », comme le dit Serge Thomazet, et d’agir potentiellement différemment en donnant un sens aux choses, pourrait-on ajouter.
Les preuves de l’impact des mots sur les pensées et les actions sont nombreuses. Un mot/concept peut être fédérateur ou clivant, produire des joies, des peurs et des représentations associées, telles que pêle-mêle les vocables : famille, intégration, banlieue, foulard, inclusion, handicap, etc.
« Quand il s’agit du monde social, les mots font les choses, parce qu’ils font le consensus sur l’existence et le sens des choses, le sens commun, la doxa acceptée par tous comme allant de soi », expliquait Pierre Bourdieu. Aussi, les connotations associées aux mots évoluent – positivement ou négativement – au fil du temps : par exemple la Puissance et la Force n’ont plus l’aura positive d’antan ; ils ont « aujourd’hui pour bien des hommes une connotation désagréable », comme le pointait Norbert Elias.
De l’intégration à l’inclusion
Concernant le contexte du handicap, des mots ont désigné différentes phases de l’Antiquité à nos jours : l’« exclusion », en passant par la « réparation/l’assistance », la « ségrégation ou séparation », puis l’« intégration » et désormais l’« inclusion ». Derrière ces mots, des discours ont émergé avec un certain consensus qui participe à conditionner nos manières d’être et les actes qui en découlent.
Sur le plan scolaire, prenons l’exemple des deux dernières périodes : pour la première, le mot intégration est majoritairement associé à l’effort d’adaptation portant davantage sur l’élève qui doit s’adapter et se plier à la majorité ; alors que pour la seconde, l’inclusion suggère fortement que c’est davantage aux instances politiques d’intervenir et aux instances scolaires de s’ajuster.
Sachant que « meilleur que mille mots privés de sens est un seul mot raisonnable, qui peut amener le calme chez celui qui l’écoute », quel est donc le bon mot, raisonnable, qui éviterait trop de bruit ou de tensions dans le message véhiculé, en ce qui concerne les politiques autour du handicap ?
Pour illustration à l’école, l’intégration – dans les classes dites ordinaires – était surtout destinée aux élèves handicapés qui pouvaient s’adapter, les lieux spécialisés étant réservés aux autres. L’effort et la responsabilité des institutions à l’égard des jeunes handicapés n’étaient pas assurés ni rassurant.
De ces freins constatés, l’évolution des mentalités et des actes a permis le passage à la période inclusive, déjà bien vécue et documentée depuis quelques années au Canada : « C’est dans ce but que certains tentent de modifier l’école ordinaire pour la rendre inclusive ». En France, l’objectif d’une école inclusive est « d’assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves de la maternelle au lycée et la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers ».
De façon caricaturale, l’effort change donc de camp et les mots choisis y contribuent : avec l’inclusion c’est désormais à la société, à l’école ordinaire de ne pas mettre en situation de handicap celles et ceux qui ont des besoins, elle doit donc se réformer et créer un périmètre plus englobant, plus élargi et plus compensant pour inclure tous les élèves.
Une inclusion trop unilatérale
Entre intégration et inclusion, le balancier semble osciller de façon assez tranchée vers les extrêmes. Dans les deux cas de figure, il révèle une trop forte asymétrie entre les personnes et les institutions. Même si, pour l’adoucir, il est réitéré que l’ambition d’une société ou d’une école inclusive ne peut pas se réaliser sans la participation active des personnes concernées et leur entourage, des associations, des partenariats, etc.
In fine, les décisions appartiennent à ceux qui ont le pouvoir de décider, pouvoir qui n’est pas encore assez mutualisé et partagé. Pour exemple, la concertation collective au sein de dispositifs d’accompagnement est parfois un affichage de façade, de « bonne » conscience institutionnelle. Dans l’intérêt des plus vulnérables, des décisions sont prises, mais leur place dans ce processus décisionnel est bien fragile.
Le « parcours du combattant » existe encore et n’est pas un vain mot. Or, la responsabilité doit être commune, exercée dans un lien de réciprocité, avec des décisions plus concertées, plus horizontales. Qui plus est, le temps des décisions et des concrétisations est rarement compatible avec celui de celles et ceux ayant des besoins particuliers.
Alors, si les mots participent à modifier des habitudes bien ancrées, pourquoi ne pas ouvrir la page d’une autre période, d’une autre impulsion, celle de l’inclusivité.
D’une société inclusive à l’inclusivité sociale
Une société inclusive serait « une société sans privilèges, exclusivités et exclusions ». Cependant, quand on évoque une société ou une école inclusive, l’ordre des mots renforce l’asymétrie contée plus haut : celle d’une société qui fait l’effort d’inclure.
Or, le concept d’inclusivité accepte une seule formulation possible : l’inclusivité sociale ou scolaire. L’action d’inclure devient première dans l’ordre des mots. De plus, le suffixe « -ité » sert à former un nom indiquant une caractéristique – à partir d’un adjectif (ici, inclusif) – ainsi qu’à exprimer une fonction ou une qualité ; celle d’impulser une action conjointe des structures et des citoyens qui résonnent dans une dynamique commune.
Si « la notion riche d’adaptation signifie adaptativité, c’est-à-dire aptitude à s’adapter et à se réadapter diversement » comme nous le dit Edgar Morin, alors, par analogie, la notion riche d’inclusion pourrait signifier « inclusivité », c’est-à-dire, l’aptitude à s’intégrer et être inclus dans un effort partagé et accepté. Si bien que le mouvement du balancier se réaliserait avec un va-et-vient plus collaboratif entre l’institution accueillante et la personne.
Le temps de l’inclusivité est-il (bien)venu ?
Lorsqu’on pianote sur Google, la recherche du mot inclusion est plus souvent liée aux personnes en situation de handicap, notamment sur le plan scolaire. Alors que l’inclusivité s’adosse davantage aux minorités de toute sorte (culturelles, linguistiques, ethniques…), aux discriminations dans le monde du travail (parité homme/femme, racisme, âgisme, etc.) aux codes de la mode, de la communication, à l’environnement physique, technique, au développement durable, etc.
Le vocable inclusivité, s’il est fortement mobilisé, servirait de tremplin à la dynamique participative des citoyens dans une liberté de choix et de décisions, sans être réduit à un simple maquillage verbal. Étant aussi chargé de mission handicap à l’université, je vois que bon nombre de personnes en situation de handicap sont désireuses de co-construire un projet sociétal véritablement pris en compte par l’institution.
Elles refusent d’être passives, dominées par une démarche descendante, même bienveillante : autrement dit, « faire pour moi mais pas sans moi ». Car elles veulent être reconnues comme pleinement citoyennes, actives, sans vivre dans l’illusion de ce qui est dit, prescrit et non suivi des faits.
Une transformation en profondeur demande un nouvel élan dans la perspective d’un véritable « faire ensemble », d’une accessibilité universelle. Sinon être en « situation de handicap » (environnement inaccessible et/ou regard stigmatisant) reflète l’échec de la société qui se dit inclusive.
Si les mots font les choses, alors bien choisis, ils pourront favoriser la concrétisation des droits, de nouvelles façons de penser et d’agir ensemble, sans distinction. En somme, la période d’une inclusivité sociale pourrait naître ou plutôt s’affirmer. Le rêve n’est pas qu’illusion.![]()
Eric Dugas, Professeur des universités en sciences de l’éducation (santé/bien-être, jeux, handicap/maladie)), Université de Bordeaux
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.